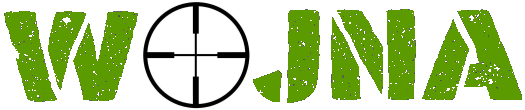Jeudi 18 septembre, huit syndicats majeurs appellent à une mobilisation nationale contre le projet de budget 2026 et la réforme de l'assurance-chômage. La CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU unissent leurs forces dans cette intersyndicale d'envergure. L'ampleur de la participation reste incertaine, mais les organisations syndicales devront fédérer bien au-delà de leurs adhérents pour gonfler les cortèges.
Cette mobilisation révèle un paradoxe français majeur : selon BFMTV, 56% du public soutient cette grève, avec 60% d'approbation chez les actifs. Pourtant, seuls 10% de la population active adhèrent aujourd'hui à un syndicat, soit trois fois moins qu'en 1950. Ce taux de syndicalisation stagne depuis les années 1990 et place la France parmi les pays les moins syndiqués d'Europe.
Perturbations massives attendues
Libération et Le Parisien anticipent entre 700.000 et 800.000 manifestants dans tout le pays. Les transports parisiens connaîtront des perturbations sévères, seules les lignes de métro automatisées 1, 4 et 14 fonctionnant normalement. Selon Libération, 98% des pharmacies interrogées prévoient de fermer leurs portes pendant la journée de mobilisation.
Le secteur énergétique coordonne sa participation avec des grèves roulantes déjà en cours depuis le 2 septembre. Cette convergence des mouvements sociaux intervient dans un contexte politique délicat, après la chute du gouvernement Bayrou et la nomination de Sébastien Lecornu.
Les racines historiques du déclin syndical
Le déclin de la syndicalisation française s'amorce dès les années 1950, après la scission de la CGT entre 1947 et 1948 qui voit naître Force ouvrière. « L'alignement très marqué du syndicat sur le Parti communiste français, en pleine période stalinienne, a découragé des salariés entrés juste après la seconde guerre mondiale, déçus par cette raideur politique », explique Sophie Béroud, politiste spécialiste de la sociologie du syndicalisme.
Cette grève du 18 septembre illustre ainsi la capacité persistante des syndicats français à mobiliser largement malgré leur faible taux d'adhésion. Le soutien public majoritaire contraste avec la réalité sociologique d'un mouvement syndical affaibli mais encore influent dans l'espace public français.
Sources utilisées : "Le Monde", "BFMTV", "Libération", "Le Parisien" Note : Cet article a été édité avec l'aide de l'Intelligence Artificielle.