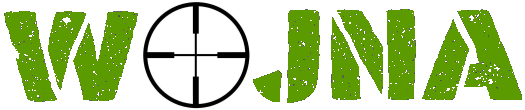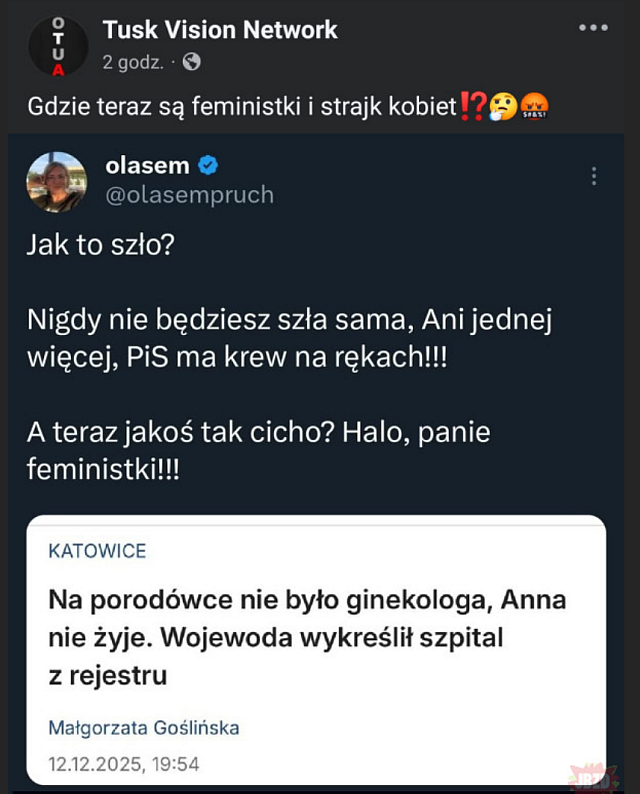La France a enregistré un nombre record d'interruptions volontaires de grossesse en 2024, année marquée par l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 251 270 IVG ont été pratiquées l'année dernière, soit 7000 de plus qu'en 2023.
Cette hausse de 2,87% prolonge la tendance observée depuis 2022. L'allongement du délai légal de recours de douze à quatorze semaines en mars 2022 n'explique pas à lui seul cette augmentation, note la DREES dans son rapport publié jeudi.
Taux de recours en hausse
Le taux de recours s'établit désormais à 17,3 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Cette progression de 2,3 points depuis 2021 touche toutes les tranches d'âge, selon l'étude officielle.
Les femmes de 20 à 29 ans présentent les taux les plus élevés. Depuis trente ans, l'avortement progresse aussi chez les 25-39 ans, tandis que les taux chutent chez les mineures, passant de 11‰ en 2008 à 5,5‰.
Débat sur les causes
Le ratio d'avortement atteint 38 IVG pour 100 naissances vivantes en 2024. Cette progression interroge sur les liens possibles avec la baisse de la natalité française, comme le souligne Le Figaro.
« Nous n'avons pas envie de faire une comparaison entre la baisse des naissances et le nombre d'IVG », commente Albane Gaillot, codirectrice du Planning Familial. « On parle de grossesses qui ne seraient pas allées à terme de toute manière. »
Pascale Morinière, présidente de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, évoque un contexte différent. « La baisse du pouvoir d'achat des familles et le contexte de crise actuel diminuent la capacité à accueillir des enfants », souligne-t-elle.
Comparaisons européennes
La France affiche un taux « extręmement élevé » par rapport aux autres pays européens. « En France, on réalise au moins deux fois plus d'IVG qu'en Allemagne », relève Pascale Morinière, regrettant « une absence de prévention ».
Franceinfo confirme des disparités régionales importantes, variant du simple au quadruple entre territoires. Ces inégalités persistent malgré l'inscription constitutionnelle du droit à l'IVG en mars 2024.
Évolution des pratiques médicales
L'IVG médicamenteuse concerne désormais 80% des avortements, contre 68% en 2019 et 31% en 2000. Cette évolution s'accompagne d'un déplacement vers les consultations externes.
Selon la DREES, 45% des IVG s'effectuent hors établissement de santé. Les interventions instrumentales ne représentent plus que 20% de l'ensemble des interruptions.
« Cela pose la question du choix des femmes », lance Albane Gaillot. « Toutes n'ont pas envie de faire une IVG médicamenteuse, notamment avec des délais avancés, où ce n'est pas simple à vivre. »
Persistance des barrières
Malgré la protection constitutionnelle, 82% des femmes rapportent des difficultés d'accès, selon Ouest-France. Des départements ferment aujourd'hui des centres de santé sexuelle, compromettant l'information et l'éducation.
Le Planning Familial bataille pour maintenir les crédits du numéro vert « IVG, contraception, sexualités ». « Il reste des enjeux éducatifs et d'accès à l'information sur ce sujet », insiste Albane Gaillot.
Sources utilisées : "Le Figaro", "Franceinfo", "Ouest-France", "DREES" Note : Cet article a été édité avec l'aide de l'Intelligence Artificielle.