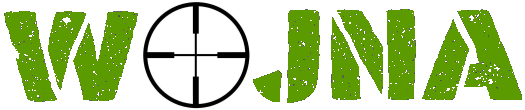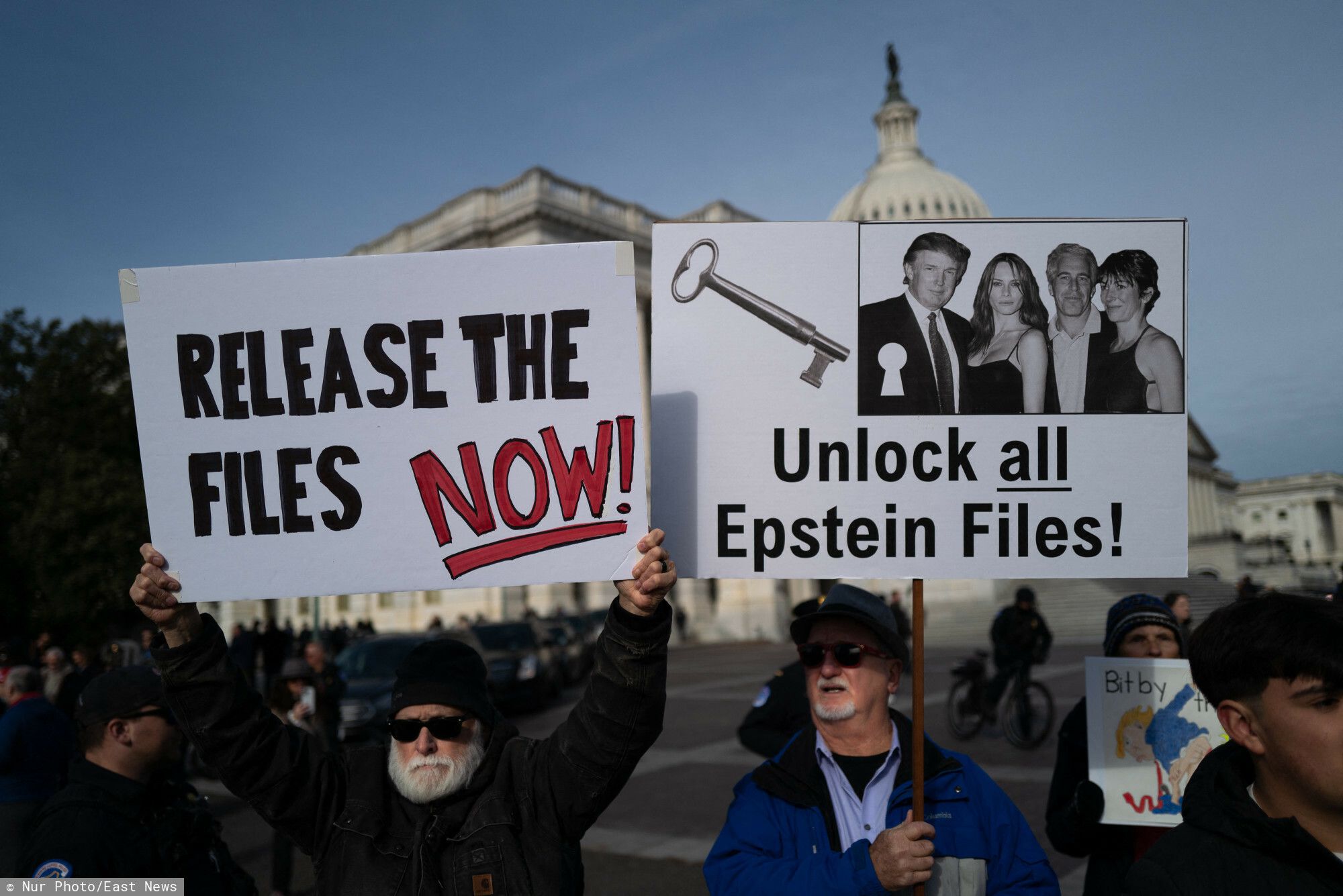Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi la création d'un nouveau «service national» volontaire et «purement militaire». Cette initiative intervient après que le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, a déclaré la semaine dernière que la France devait ętre pręte à «accepter de perdre ses enfants», ravivant les craintes d'un conflit européen élargi avec la Russie.
Macron a précisé que ce service n'est pas destiné à envoyer des jeunes en Ukraine. L'annonce s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes, alors que le conflit ukrainien dure depuis près de quatre ans et alimente des inquiétudes sur une possible extension du conflit.
Vives réactions politiques
Les propos du général Mandon ont «hérissé» les partis d'opposition, notamment La France insoumise et le Rassemblement national. La cheffe des députés Insoumis, Mathilde Panot, a accusé le président sur franceinfo de «concentrer le pays sur des menaces qui sont incertaines». L'eurodéputée Manon Aubry lui a reproché de préparer la jeunesse «à mourir pour ses guerres».
À l'inverse, Raphaël Glucksmann, leader du parti de gauche Place publique, s'est prononcé en faveur d'un service obligatoire, militaire ou civique, et a défendu les déclarations du général Mandon. L'ancien président socialiste François Hollande a appelé à se «préparer à toutes les hypothèses» face à la menace russe, tout en mettant en garde contre le risque d'«affoler» l'opinion publique.
Une opinion publique inquiète
Un sondage Elabe réalisé cette semaine révèle que 62% des Français estiment que la Russie pourrait attaquer militairement un membre européen de l'OTAN. La majorité juge toutefois improbable une agression armée directe sur le territoire français.
Cette anxiété se retrouve également chez les dirigeants d'autres pays européens, particulièrement en Europe de l'Est. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a récemment évoqué des historiens militaires selon qui «nous avons déjà connu le dernier été de paix».
Un débat sur la communication de la menace
Pour Vincent Martigny, professeur en sciences politiques à l'université de Nice, les questions de défense «ne pèsent quasiment rien dans une campagne électorale». Il explique que de nombreux politiques évitent le sujet par manque de «compétences en terme de défense et de stratégie», soulignant un «désengagement» ancien.
Selon lui, «il n'y a pas de clivage pacifiste/va-t-en-guerre, mais un désaccord sur la façon dont il faut parler de l'éventuelle menace russe à l'opinion». Il juge qu'«un mode très pacifiste» serait «contre-productif» pour alerter l'opinion. S'emparer de ce thème régalien permet à un parti «d'apparaître comme un parti de responsabilité» ou au chef de l'État de transcender les querelles politiques.
Jean-Vincent Holeindre, professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas, considère comme «plutôt sain» le retour des questions militaires au centre des discussions. Il note le caractère «strident» des remarques de Mandon et observe un «repli sur la sphère privée» dans la société française. Il explique que le refus français de voir les conflits mondiaux découle d'une longue période de paix: «C'est d'abord parce qu'il y a eu un refus de voir ce qui se passe [...] de la part d'une société française qui est en paix depuis très longtemps et ne voit pas que le monde, lui, continue à ętre en guerre.»
Il reste toutefois sceptique: «Malheureusement, dans un contexte politique tellement troublé, est-ce que ça va permettre vraiment de faire avancer le débat? Je ne suis pas certain.»
Note : Cet article a été créé avec l'Intelligence Artificielle (IA).